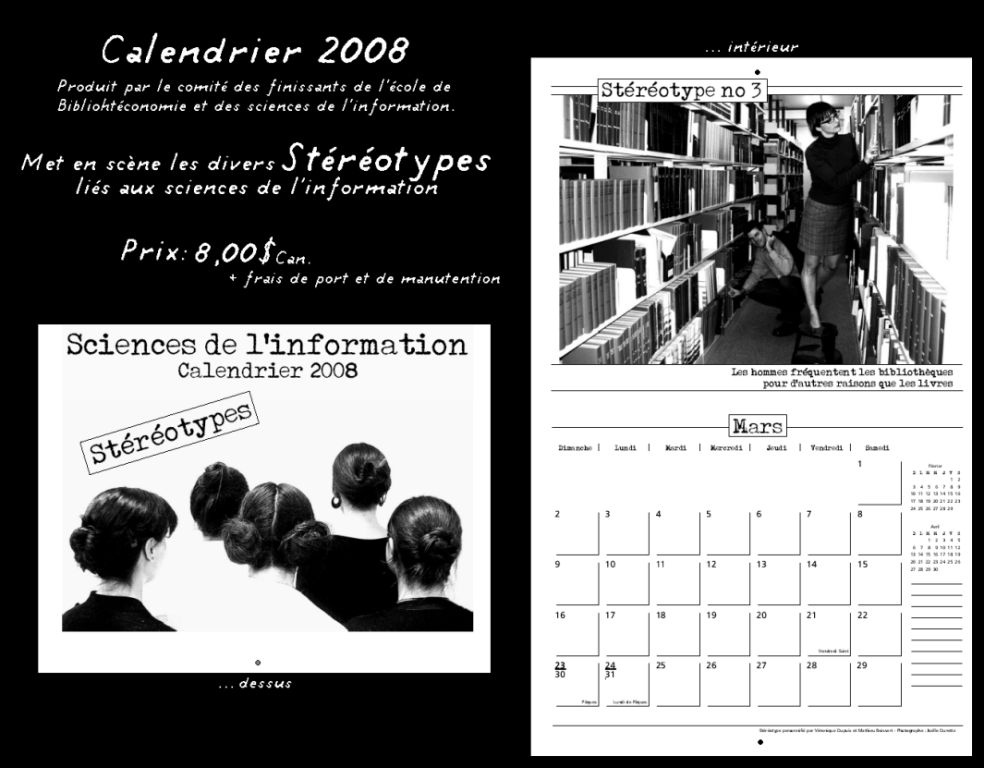Une étude statistique de l'actualité parue en 2007 dans les médias québécois, comprenant quelques points de comparaison avec les médias internationaux vient d'être mise en ligne. On peut regretter que la méthodologie ne soit pas plus explicite (on n'en apprend pas beaucoup plus sur le site de la société). Mais le rapport mérite lecture et les chiffres présentés sont suffisamment tranchés pour être significatifs.
État de la nouvelle : Bilan 2007, Influence Communication, décembre 2007, 76p, Pdf.
Voilà, selon les auteurs de l'étude les nouvelles les plus représentées dans les médias dans le monde (120 pays, 632 millions de nouvelles analysées) :

Ils ajoutent, extrait :
Pour illustrer l’importance de l’attention médiatique accordée au lancement du nouveau tome d’Harry Potter, elle représente l’équivalent de toute la couverture accordée dans le monde aux évènements suivants réunis :
Ouragan Dean, feux en Grèce, conflit au Darfour, inondations en Afrique, inondations aux Royaume-Uni, guerre civile en Somalie, tremblement de terre dans les îles Solomon, coulée de boue à Chittagong, tremblement de terre au Pérou, guerre au Tchad, tremblement de terre dans le fjord de Aysen, tremblement de terre au Guatemala, ouragan Jerry, feux à Angora, coulée de boue en Bulgarie, rébellion au Touareg, tremblement de terre de Noto, insurrection en Thailande, insurrection Kurde, inondations en Asie du Sud, ouragan Umberto, inondations dans le Mid-Ouest américain, tremblement de terre sur l’Île de Kuril, rébellion en Papouasie, ouragan Lorenzo, guerre civile en Ouganda, tremblement de terre dans la péninsule ibérienne, tremblement de terre au Laos, tremblement de terre à Sumatra, coulée de boue en Asie, bombardement au Malie, conflit au Cachemire, conflit dans le Delta du Niger, explosion à Alger, explosion au Sri-Lanka, explosion à Batna, explosion à Casablanca, ouragan Gabrielle, incendies en Croatie, explosion à Bikfaya, explosion à Hyderabad, ouragan Félix ainsi que l’explosion à Zahedan.
La présence de Harry Potter au 7ème rang, seul évènement culturel du classement, est en effet significative. Sans doute c'est une exception et le résultat d'un marketing remarquablement efficace, néanmoins faut-il rappeler qu'il s'agit d'un livre ? Un livre édité sur papier, ce support dont combien prédisent chaque année la mort prochaine..?
Tout aussi significatifs sont les points de comparaison pris par les auteurs du rapport : catastrophes en tous genres (naturelles, attentats, guerres..) qui par nature sont inscrites dans un territoire et donc à tort ou à raison rapidement réduites à une couverture locale. Les seules catastrophes à réussir à entrer dans le top 15 sont celles qui concernent les US, biais peut-être déformant de l'échantillon mais surtout sans doute hégémonie du territoire américain comme grand récit médiatique. Ainsi Harry Potter, lui même grand récit, est le seul à avoir rivalisé avec le rêve américain dans les médias.
Par ailleurs, le Québec, par la petite taille de sa population (et donc le nombre forcément réduit de médias) et par sa forte identité qui tranche avec ses voisins, est, ou pourrait être, une sorte de laboratoire médiatique. Cette étude l'illustre de façon éclatante. Il serait trop long d'en rendre compte en détail et dépasserait le périmètre de ce blogue. Au delà de son intérêt pour tous les professionnels de la communication, la comparaison des rapports annuels avec l'histoire immédiate de la province, à peine esquissée et pourtant oh combien stimulante ! dans le rapport, apporterait à partir de cette étude de cas une meilleure compréhension de la construction du récit médiatique.
Pour revenir à la thématique du blogue, voici un extrait de la réflexion du pdg de la société sur les conséquences de l'explosion numérique :
L’auditoire se fractionne au profit d’une multitude de sources et de supports. Les MP3, les chaînes spécialisées, le web, les blogues et les quotidiens gratuits proposent une offre qui accélère la segmentation des auditoires. Contre la dizaine de quotidiens imprimés que compte le Québec, plus de 60 sites d’information diffusent de l’information quotidiennement, sans parler des blogues et les sites personnels. Cette fragmentation favorise d’ailleurs une consommation à la carte, rendant presque utopique la fidélisation des consommateurs. Nous sommes exposés à un volume croissant de médias et de nouvelles. Tributaires de l’actualité, les médias n’en augmentent pas moins le volume de nouvelles. De 2005 à 2006, Influence Communication a constaté une augmentation du nombre de sujets de près de 20i%. Pourtant, l’actualité ne propose pas plus d’événements qu’auparavant. Pour combler tous les besoins et éviter de se laisser dépasser par la concurrence, les médias élargissent rapidement leur échantillon de nouvelles. Mais si les journées n’ont toujours que 24 heures, comment accroître l’inventaire des nouvelles?
Rien de plus facile. Il s’agit de réduire considérablement l’espérance de vie des nouvelles. Aujourd’hui, 85% de l’information disparaît en 24 heures ou moins. Il y a dix ans, 25% de l’actualité suscitait encore de l’attention 72 heures plus tard. Nous sommes donc bombardés par l’information souvent redondante, mais sans cesse renouvelée, d’un réseau à l’autre. Nous sommes plus informés que jamais, mais avec beaucoup moins de profondeur. (..)
Cette remarque doit être nuancée. En effet, le rapport montre qu'entre 2006 et 2007, le nombre de nouvelles dans les médias traditionnels du Québec a, au contraire, baissé de 10%. Et voici la solution proposées aux médias québécois, qui tranche avec ce qu'on lit habituellement :
La solution repose peut-être en partie sur la complémentarité des contenus traditionnels et dans la spécialisation des services. Si les impératifs commerciaux rendent les distinctions entre les réseaux de plus en plus ténues, pourquoi ne pas profiter d’internet pour y déployer des spécialisations ? Il pourrait s’agir de sites «verticaux», spécialisés dans un type d’information. (..)