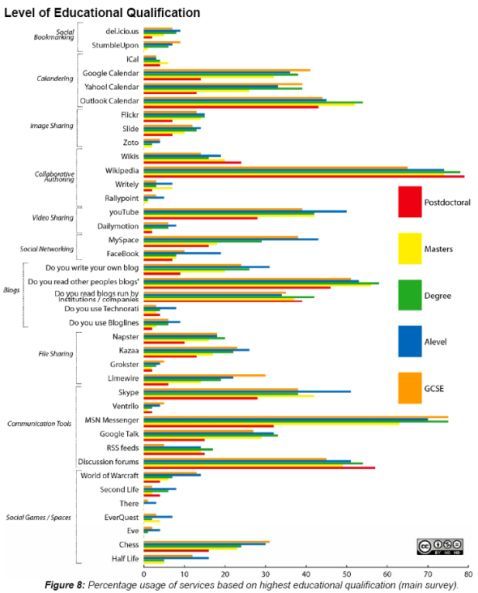En cette fin de semaine de fin de session, j'avais envie de prendre un peu d'air. L'occasion m'est donnée par la fermeture d'un livre étonnant, une réminiscence savante et une visite stimulante.
Le livre est sorti tout récemment en version française chez Albin Michel, mais il a déjà fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis : 1491. Nouvelles révélations sur les Amériques avant Colomb, Charles C. Mann. On trouvera ici un résumé en anglais, de ses thèses par son auteur dans le numéro de mars 2002 de la revue The Atlantic, et là un extrait du livre par la revue Lire, à mon avis pas vraiment représentatif mais en français.
Le livre, reportage sur les récentes découvertes archéologiques, reconstitue le puzzle d'une Amérique pré-colombienne, largement plus peuplée que l'Europe, riche de nombre de civilisations organisées, à l'histoire mouvementée, fécondes en art, architecture, technique et botanique, victime d'un cataclysme sanitaire et écologique et dont on aurait, sans vraiment le vouloir, oublié les très nombreux apports à notre monde moderne. Je ne saurais discuter la pertinence des thèses présentées, mais ce qui m'a fasciné, c'est la perte de la mémoire d'une part importante de l'humanité et la volonté actuelle et bien délicate de la reconstituer.
Cette lecture m'a rappelé les travaux des historiens français du livre et, plus précisément, du groupe de Christian Jacob sur les mondes lettrés. La tentative, peut-être un peu démesurée, est de reconstruire le fil des pratiques intellectuelles dans un continuum reliant le technique, le social et le mental. Le plus fécond de ces travaux est l'approche comparatiste entre les civilisations qui dénoue les fils de la construction de la mémoire inscrite d'une société et sa possibilité d'interprétation en soulignant ses dimensions sociales. Un livre, paru en 2003 témoigne de l'importance de cette réflexion : Des Alexandries. II, Les métamorphoses du lecteur, sous la dir. de Christian Jacob. Paris : Bibliothèque nationale de France. Cet article accessible en ligne sur une comparaison entre l'histoire des bibliothèques de la Grèce et de la Chine antiques est tout aussi révélateur de la démarche. Comme pour le livre précédent, pour moi l'intérêt est autant dans le contenu des travaux que dans la posture très européenne de ces chercheurs dont les travaux ont l'ambition d'embrasser aussi la période contemporaine et donc le numérique à partir des mêmes prémisses intellectuelles.
La visite est celle de Bruno Bachimont à l'EBSI où il a présenté les réalisations de l'institut National de l'Audiovisuel (INA) sur le traitement et la valorisation des archives de la radio-télévision française. La réussite est sans doute due à l'intelligence et l'habileté des promoteurs du projet, mais aussi à une alchimie française particulière entre centralisation, souci patrimonial et ingéniosité. C'est un des exemples les plus féconds de redocumentarisation par le numérique où le travail d'indexation des documentalistes sert à la fois à une valorisation éditoriale et à une réutilisation des unités documentaires découpées, mais mises en contexte, la concrétisation d'une archithèque. Là encore, l'intérêt pour moi réside aussi bien dans l'explication contextuelle de cette réussite que dans ses réalisations numériques.
Entre ce continent, qui tente de reconstruire en tâtonnant, non sans mal ni approximation, une histoire perdue tout en basculant à grande vitesse dans une autre époque où sa mémoire immédiate est pour le moins bousculée, et cet autre, fort mais lourd d'un patrimoine documentaire accumulé qui tente d'appliquer souvent maladroitement ses traditions à un matériau qui lui échappe, il pourrait y avoir des croisements féconds. Est-il téméraire de penser que le Canada et singulièrement le Québec, par leurs positions - géographique et culturelle - particulières, leur bilinguisme, leurs ouvertures multiculturelle et technologique, pourraient être le creuset d'un alliage inédit ?
Bon assez rêvé, il reste des copies à corriger..