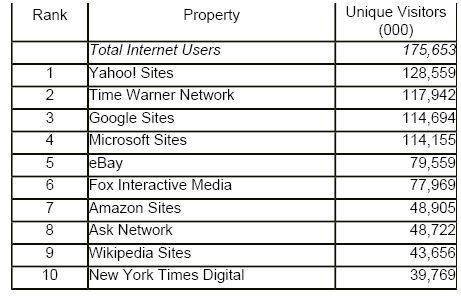À lire absolument un entretien (avec qui ? je ne sais cela n'est pas indiqué dans la version en ligne !) très clair, précis et percutant, sur les enjeux politiques et commerciaux de la gouvernance d'Internet publié dans le Monde. Il souligne en particulier les divergences entre les US et la Chine ou entre l'internet traditionel et celui des objets :
Qui contrôlera demain Internet ? LE MONDE | 31.03.07 | 13h55 Propos recueillis par Stéphane Foucart
Extraits :
La Chine a essayé à plusieurs reprises, de s'éloigner des standards techniques de l'Internet. Ces tentatives auraient pu aboutir à la fragmentation ou à la balkanisation du réseau, c'est-à-dire la formation d'"îlots" peu connectés entre eux. Mais la Chine peut-elle encore se permettre de créer un Réseau incompatible avec le reste du monde ? Elle a besoin des innovations de l'Ouest pour alimenter une croissance qui est devenue cruciale pour la survie politique du régime. Si l'Iran a décidé récemment de réduire le débit des accès Internet de ses citoyens afin de freiner les échanges avec l'Occident, de telles mesures ne pourraient plus être adoptées en Chine. (..)
Si le premier milliard d'internautes s'est connecté au Réseau par le biais des ordinateurs, le deuxième milliard sera connecté à Internet par le biais de toutes sortes d'objets, qu'il s'agisse des produits alimentaires, des vêtements ou des livres... à mesure que les codes-barres présents sur les objets manufacturés seront remplacés par des puces sans contact (ou puces RFID, comme la puce qui équipe la carte Navigo des Franciliens).
Le consortium mondial de gestion des codes-barres, EPC Global, a choisi un système qui permettra à terme de stocker sur Internet toutes les informations relatives à la vie de ces objets (lieu de fabrication, acheminement, contrôles effectués, etc.). Ce changement vers un "Internet des objets" sera effectué pour des raisons logistiques, d'économie et de traçabilité. Cela générera d'importantes économies pour les distributeurs. (..)
En effet, s'il devient possible de connaître les mouvements de tous les objets et personnes sur l'ensemble de la planète, le gouvernement qui contrôlera ce système détiendra un pouvoir qu'aucun gouvernement n'a jusqu'ici rêvé de posséder.
Réflexions d'escalier le 01-04-2007 :
1) Le vieux débat du NOMIC (Nouvel Ordre Mondial de l'Information et de la Communication) est réactivé sur le Web. Il se décline différemment puisque le réseau des réseaux se joue des frontières, mais il est toujours aussi ambigu entre d'une part une tentation très forte des États pour contrôler la circulation des messages et, de l'autre, une dynamique de marché qui favorise certains joueurs. Au moment où la convention sur la diversité culturelle est entrée en vigueur, il serait utile de mieux tirer les leçons des batailles antérieures. On trouvera une bonne introduction sur cette question dans : Alegre Alan, O'Siochru Sean, Droits de la communication, in Enjeux de mots, C&F Éditions, 2005.
2) La montée de l'Internet des objets risque de séparer plus radicalement l'utilisation du réseau en une partie gestion de service et une partie Web-média dont j'essaie de souligner les contours, billet après billet dans ce blog.
Actu du 4 avril : Donc il s'agit de Bernard Benhamou. Pour plus de précisions voir les commentaires ;-)