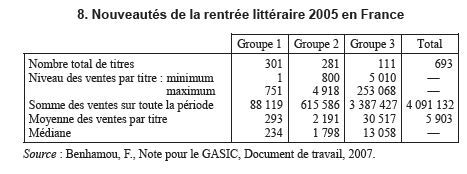Je le signale juste pour mes lecteurs québécois. Cela n'a pu échapper aux Français tant l'effet de mise en abîme est ici saisissant. La presse de l'Hexagone est entrée, non sans quelques complaisances, dans une vaste réflexion sur elle-même grâce aux États-Généraux de la presse, lancés de façon quelque peu paradoxale par le plus monarchique des présidents français.
C'est une occasion unique pour obtenir des informations sur ce secteur en crise. Un site Web est entièrement dédié au processus, une mine pour les observateurs, étudiants, professeurs, chercheurs.. Tous les blogues de journalistes bruissent du sujet et les journaux eux-mêmes ne sont pas en reste.
Un regret pourtant : le site est un site de journalistes, construit pour rendre compte de l'information au jour le jour. Sans doute Il aurait été plus efficace ici de faire appel aux compétences en sciences de l'information. Car il faut ici accumuler, classer pour retrouver et analyser, et non entasser les postures convenues ou rendre compte de la dernière audition. Mais il paraît que l'on découvre l'existence de Journadocumentalistes là-bas, il y a de l'espoir ;-).
Complément du 24 octobre 2008
Et pour la presse US, l'équivalent au même moment :
New Business Models for News Summit, 23 octobre 2008, New York. Repéré par Jean-Marie Le Ray qui le commente.