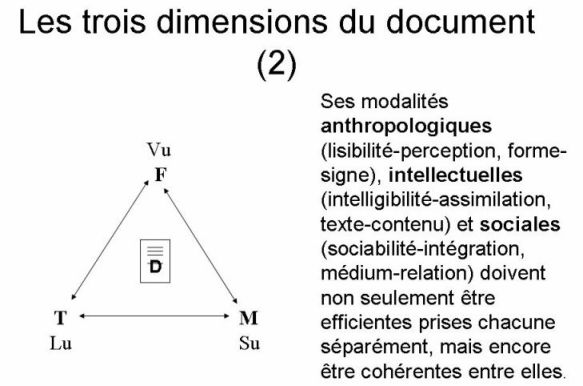Y a-t-il rapport entre les mangas japonais et les Têtes à claques québécoises ? Lointain dira-t-on, sinon qu'ils ont, les uns et les autres, de plus en plus de succès sur les téléphones cellulaires. Je voudrais en suggérer ici un autre, qui explique le premier, inattendu mais plein de leçons, au risque de chagriner peut-être quelques-uns de mes amis québécois, justement amoureux de la pureté de leur français.
Le succès des mangas au Japon de date pas d'hier. Ils forment une véritable industrie dont la bande dessinée, conçue pour être lue vite dans les transports en commun, est la pierre angulaire, mais qui déborde sur les dessins animés, les jeux vidéos et toute une gamme de produits dérivés.
Aujourd'hui, les mangas tirent le marché du e-book sur les cellulaires qui, selon un billet de l'Atelier a connu une croissance fulgurante de 331,3% à une valeur totale de 6,9 milliards de yens (environ 42,4 millions d’euros) en 2006 bien qu’il ne représentait que 1,6 milliards de yens (environ 9,8 millions d’euros) en 2005. On prévoit une croissance encore supérieure pour 2007.
De leur côté, le succès des Têtes à claques est beaucoup plus modeste (à l'échelle du Québec) et beaucoup plus récent. Mais, comme l'a signalé M. Lessard, ils viennent de s'implanter en France en participant à la campagne de promotion d'un opérateur de télécom pour ses nouveaux forfaits.
La valorisation du contenu sur les cellulaires est rendue difficile à cause des limites du médium : l'écran est petit, très petit. Le son est médiocre, même si les dernières générations promettent monts et merveilles. Et surtout le signal, pas toujours fiable, rend difficile l'envoi généralisé de contenus trop lourds, sauf dans les rares endroits où les infrastructures le permettent comme en Corée (voir ce billet).
Un des avantages du Japonais, dans sa forme écrite, est la multiplicité des signes qu'il utilise : Deux alphabets (un pour les mots originaires de l'ile, l'autre pour ceux venus d'ailleurs), l'utilisation fréquente de sinogrammes, et même la possibilité d'utiliser l'alphabet roman, lu par la plupart. Les mangas ont utilisé graphiquement ces facilités depuis leur origine, au point d'en faire un élément esthétique et signifiant. Cette richesse graphique se décline parfaitement dans des cases.. ou des écrans de téléphone donnant une grande expressivité au récit. On peut s'en convaincre facilement, même sans comprendre le Japonais en « feuilletant » un manga à partir cette page (cliquer p. ex. sur un des trois liens en haut et à gauche de la page). Inversement, la bande dessinée de l'école belge ou encore américaine, ne dispose pas de ces facilités. De même, l'exportation des mangas à l'extérieur du Japon réduit cet avantage. Il suffit de comparer les exemples précédents avec cette démo (cliquer sur l'encadré du haut) pour être convaincu.
Alors quel rapport avec les Têtes à claques ? Côté visuel, elles ne tiennent pas la comparaison. Il s'agit d'une esthétique Guignol laissant très peu de place à l'expressivité. Mais ce qu'elles perdent à l'image, elles le regagnent au son. Et là le parallèle est surprenant :
- Comme les mangas utilisent deux alphabets pour une seule langue, les Têtes à claques utilisent deux Français (québécois et hexagonal). Ici par ex. Et voir le lexique sorti pour la campagne de promo citée.
- Comme les premiers importent finement des signes de leur grand voisin, les seconds intègrent joyeusement des anglicismes. Voir le plus populaire.
Bien sûr ni les uns, ni les autres ne sont responsables de cette sémiotique qui fait partie de la culture du peuple, jouant l'une sur l'écriture, l'autre sur la parole. Néanmoins, les deux ont eu le talent de l'exploiter en transcendant les limites d'un médium.
Contrairement aux mangas, les Têtes à claques ne sont pas un genre, juste un succès ponctuel. Mais si l'on poursuit le raisonnement précédent, et que l'on pense à la diversité de la francophonie, il y a peut-être là matière à développement..