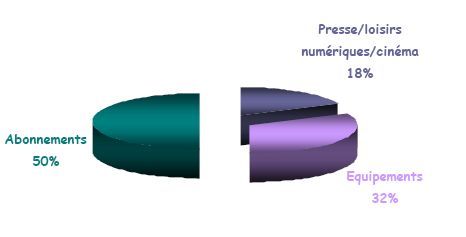Ce billet a été rédigé par Sandrine Vachon, étudiante de l'École de bibliothéconomie et de sciences de l'information dans le cadre du cours Économie du document.
La popularité des encyclopédies numériques ne se dément pas : alors que Wikipédia se range toujours parmi les 10 sites les plus consultés du Web, faisant fureur auprès des étudiants et de tous les curieux de la planète, une dépêche du Calgary Herald (ici) nous annonçait, à la fin août, que même le Sénateur John McCain utilisait un peu trop l’encyclopédie collaborative dans ses discours électoraux. Cet exemple nous éclaire sur la portée de Wikipédia et sur le changement radical qui s’est opéré dans les habitudes de recherche de tout un chacun ; désormais, il n’est plus question de perdre son temps à fouiller dans de gros bouquins, alors que toute l’information désirée est à un simple clic de souris…
L’arrivée de Wikipédia dans le monde des encyclopédies a créé des remous à plusieurs niveaux. De nombreux détracteurs ont critiqué l’aspect collaboratif de l’encyclopédie, effrayés à l’idée que n’importe quel individu, sans être expert, puisse écrire des articles encyclopédiques, ou en corriger d’autres. Pierre Gourdain et alii ont d’ailleurs consacré la presque totalité d’un livre (La révolution Wikipédia : les encyclopédies vont-elles mourir? BBF ) à essayer de convaincre le public de la non-validité des articles de cette encyclopédie. Et ce n’est qu’une récrimination parmi tant d’autres! Je me pencherai plutôt sur les enjeux économiques reliés aux encyclopédies numériques, dont on parle un peu moins dans les médias.
Sur ce blogue, Jean-Michel Salaün a analysé trois facettes économiques utilisées ou affectées par Wikipédia (ici). Il s’agit des économies de la cognition, de l’attention et du don. Il est possible de dire que Wikipédia participe à l’économie de la cognition puisque l’encyclopédie a un impact sur le monde de l’éducation. Toutefois, cet impact n’est pas économique dans un sens traditionnel, puisqu’aucun étudiant ou professeur ne doit payer pour la consulter. De la même façon, Wikipédia participe à l’économie de l’attention (publicité) en créant une plus grande affluence sur les moteurs de recherche, permettant ainsi aux publicitaires de rejoindre un plus grand marché. Là encore, ce n’est pas Wikimedia, la fondation derrière Wikipédia, qui en profite, mais bien d’autres acteurs du web, comme Google. Enfin, Wikipédia fonctionne grâce à l’économie du don, puisque tous ses revenus proviennent de dons de particuliers ou d’entreprises prélevés lors de levées de fonds. Sur le site wikipédien de la fondation, on explique que “96% du budget de la Fondation Wikimedia provient des dons individuels, et que ce sont généralement de petits montants.(sic) .» Afin de convaincre les gens de donner, la Fondation insiste sur les projets qu’elle désire développer à l’extérieur des Etats-Unis, comme en Afrique, afin d’augmenter le nombre d’articles écrits en différentes langues. Mais il ne faut pas se leurrer : ce qui attire les dons, bien plus que les projets, est l’image de marque de l’encyclopédie. Car Wikipédia a un pouvoir d’attention qui dépasse celui de bien des ONG, et qui se rapproche davantage de celui des grandes compagnies de ce monde, telles que Nike ou Gap! La preuve en est que la Fondation Wikimedia, lors de sa dernière levée de fonds, a amassé 2.162 millions de dollars de 45.000 donneurs à travers le monde (Rapport de la fondation). Avec un tel montant, nul besoin de diffuser de la publicité !
Les encyclopédies plus traditionnelles essaient bien sûr de rester dans le coup, sans grand succès. Par exemple, l’Encyclopedia Britannica permet depuis peu de temps de collaborer à l’encyclopédie en écrivant des articles parallèles reprenant des informations présentes dans les « vrais » articles de l’encyclopédie (Toronto Star, 6 juin 2008). Toutes les créations d’internautes sont vérifiées par les collaborateurs de l’Encyclopédie. Britannica tente d’intéresser les gens en tirant parti de son prestige, en participant à la vague collaborative et en faisant miroiter la possibilité de conserver les bons articles dans la vraie encyclopédie. Mais une entreprise comme celle-ci, malgré sa longévité, peut-elle réellement faire face à l’effet de masse créé par Wikipédia ? Et surtout, combien de gens s’abonneront réellement à sa version numérique pour 69,95$ par année, alors que les encyclopédies gratuites sont satisfaisantes ? En passant de 1395$ pour les 32 volumes de l’encyclopédie à 69,95$ pour la version numérique, on peut dire que les éditeurs traditionnels ont tout un défi économique à relever ! Malgré cette baisse de prix impressionnante, ils n’arrivent même pas à concurrencer les encyclopédies qui n’existent qu’en version numérique, comme Encarta, qui se vend 30$ par année.
Une solution semble « parfaite » pour l’entreprise: c’est celle que préconise l’encyclopédie Knol de Google. Ses articles sont signés par des experts dont l’identité est vérifiée. Le terme « expert » est ici un peu élastique puisqu’un diplôme ne garantit pas nécessairement qu’aucune erreur ne sera faite. Google réussit à attirer ces experts grâce à sa notoriété (nous savons que l’image de marque de Google occupe une très grande place dans l’économie de l’attention sur le Web). Elle leur promet aussi une partie des revenus assurés par les publicités présentes dans leurs articles, en fonction du nombre de personnes qui les lisent. Google a le prestige nécessaire pour que Knol devienne le prochain Wikipédia, mais les utilisateurs se lasseront-ils de la publicité, alors qu’ils sont habitués à ne pas en avoir sur les pages wikipédiennes ? Il n’y a pas que la gratuité qui soit attirante pour les internautes, et une solution intéressante sur le plan économique pourrait en rebuter plus d’un sur le plan éthique : information pertinente, produits de beauté et publicités de voitures de luxe peuvent-elles réellement faire bon ménage ?